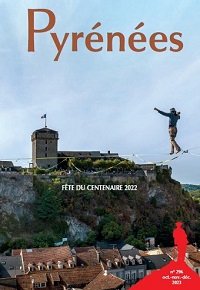Accueil > 07. LIBRAIRIE & VIDÉOTHÈQUE > Vient de paraître > PAYS PYRÉNÉENS ET ENVIRONNEMENT
 PAYS PYRÉNÉENS ET ENVIRONNEMENT
PAYS PYRÉNÉENS ET ENVIRONNEMENT
Pays pyrénéens et environnement
Fédération historique de Midi-Pyrénées - Société Ramond
Parution 2016, 532 p.
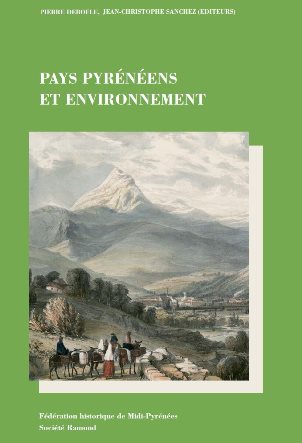
À l’occasion du cent cinquantenaire de la fondation de la Société Ramond, le congrès biennal de la Fédération historique de Midi-Pyrénées s’est tenu à Bagnères-de-Bigorre du 12 au 14 juin 2015 avec comme sujet « Pays pyrénéens et environnement ».
150 ans après sa fondation la Société Ramond, au pied du Pic du Midi, réunissait plus de 70 conférenciers d’Andorre, d’Espagne et de France qui ont fait partager avec passion leurs travaux et cela dans une perspective largement interdisciplinaire, sur l’histoire longue de l’environnement dans la chaîne pyrénéenne et son piémont.
Les Actes de ce Congrès viennent d’être édités par la société Ramond. Son président, Pierre Debofle, nous en livre un résumé :
L’ouvrage s’ouvre sur une communication de Georges Bertrand, professeur émérite à l’université Toulouse 2-Jean Jaurès et Pierre-Yves Péchoux, président de la Société de géographie de Toulouse, « Regards sur l’environnement des pays pyrénéens ». Pierre-Yves Pechoux pose plusieurs questions, dont la première est de constater que depuis un satellite, les Pyrénées ne sont guère perçues que comme un « incident topographique à l’extrémité du continent eurasiatique » et de s’interroger : « Les Pyrénées sont-elles un isthme ? » Une charnière raccordant la péninsule ibérique au reste du continent, ou plus modestement, une « apparence d’isthme ». La seconde question est de se demander si les Pyrénées constituent une barrière, une véritable séparation. La montagne est à l’évidence un obstacle contraignant pour les populations. Entre le bassin aquitain et la péninsule ibérique, les Pyrénées « s’affirment donc comme montagne et comme obstacle du simple fait de leur masse, de leur élévation et de l’énergie de leurs dénivellations ». Un appareil montagneux étendu dont l’épaisseur peut atteindre jusqu’à 160 km en comprenant les Pré-Pyrénées, jusqu’aux abords de Saragosse et du sillon de l’Ebre, avec la constatation que les deux tiers de sa superficie appartiennent à son versant méridional. Un ensemble massif et continu de 55000 km2 à la surface du continent européen, que le géographe Elisée Reclus qualifiait en 1876 de « véritable rempart » et même de « mur ». Ainsi le percevaient déjà aux Xe-XIIe siècles des auteurs andalous. Muraille naturelle, les Pyrénées sont-elles une « frontière ambiguë » ? Une frontière naturelle, quand de multiples exemples, le long de leur ligne, semblent apporter un solide démenti à cette affirmation : enclave de Llivia, Val d’Aran, usage du catalan ici, du gascon là qui débordent du cadre frontalier ; au Pays basque, le Pays Quint ; partage des estives, partage des eaux démontrant que « bergers et agriculteurs ne peuvent vivre en s’en tenant à une frontière linéaire tracée par des topographes sur leur table à dessin puis bornée par d’autres sur le terrain qui est le leur ».Toutes ambiguïtés nées du traité des Pyrénées de 1659 ; et que dire du cas particulier de l’Andorre à la souveraineté partagée entre France et Espagne à travers ses coprinces, le roi de France puis le président de la République et l’évêque d’Urgell ? Sans parler des bizarreries : l’île minuscule et inhabitée des Faisans ou de la Conférence sur le cours de la Bidassoa, souveraineté « semestrielle » partagée entre France et Espagne, dont le territoire doit être maintenu intact contre l’érosion de l’eau. Une frontière qui finalement, sujette à des mouvements saisonniers de population, n’a guère été véritablement étanche au cours des siècles, pas même sous la dictature de Franco !
Dans la réflexion qu’il conduit dans la suite de l’exposé, Georges Bertrand reprend le constat dressé en 1974 sous la direction de François Taillefer dans l’ouvrage collectif Les Pyrénées de la montagne à l’homme, d’un milieu pyrénéen en crise. Si le paysage pyrénéen change, le regard des hommes doit lui aussi changer. Et il s’interroge sur la notion de « pays pyrénéen », avec toute la complexité « d’appellations de pays de toutes configurations, tailles et contenus », retenant modestement ce que les hommes, occupants et historiens vivent et retiennent comme pays, « unité de base, historique et territoriale, de la vie pyrénéenne », avec sa propre identité fortement revendiquée et un rôle fondamental de l’environnement pris dans son sens le plus large, le tout formant une mosaïque avec la vallée pour centre de gravité, ce qui conduit, en termes d’aménagement, à parler de « système valléen » qui structure la vie collective de la communauté pyrénéenne. Autre réflexion, sur la notion d’étagement, de distribution suivant l’altitude des paysages et de leurs activités, agricoles, forestières, pastorales, somme toute très classiques des pays de montagne, mais où le risque de « perte de contrôle » de cette verticalité est réel et fragilise l’environnement ; en témoigne la disparition progressive des soulanes en cours d’abandon et qui ne survivent que par la pastoralisation extensive et la transformation de l’habitat en résidences secondaires. Elle marque la fin du système agro-sylvo-pastoral. Les grandes vallées qui conduisent de chaque côté de la chaîne aux deux piémonts, irriguées par les cours d’eau, concentrent l’essentiel de la vie économique et sociale : là sont la majorité des villes et des villages, les voies de communication, les activités thermales, industrielles et commerciales.
L’environnement est devenu aujourd’hui la question centrale et une perspective positive pour la société pyrénéenne et son économie. Sa dégradation porte essentiellement sur la moyenne montagne. Mais cette disparition des terroirs traditionnels n’est pas celle des pays qui s’organisent autour des intercommunalités. On remarque aussi un double mouvement de glissement géographique des centres de gravité, d’abord vers le bas, dans les vallées principales et les zones de piémont, pour le peuplement et les activités économiques, puis vers le haut, dans les zones d’estives et les champs de neige avec une urbanisation plus ou moins bien contrôlée et parfois anarchique qui caractérise les stations de sports d’hiver qui sont aussi de plus en plus fréquentées en été ; le tout engendrant des altérations diverses du paysage. L’environnement est donc de nos jours au cœur de l’aménagement des pays pyrénéens et de leur développement à venir, ouvrant la voie à « une révolution environnementale et paysagère », mais non sans rencontrer des résistances.
Après ce dense exposé introductif, Pierre Debofle, président de la Société Ramond résume brièvement l’histoire de la Société, plus ancienne société montagnarde de France, dont les 150 ans d’existence rassemblaient les participants à ce congrès. Née en 1864, à Gavarnie, implantée à Bagnères-de-Bigorre, elle allait réunir, à travers ses fondateurs, son premier président, le pasteur Emilien Frossard et ses membres, tout ce que le pyrénéisme devait compter de noms illustres, de Charles Packe et Henry Russell à Franz Schrader, publier un Bulletin, enrichir les collections publiques (l’herbier de Ramond, éponyme de la société, est aujourd’hui déposé au Conservatoire botanique pyrénéen de Bagnères) et créer l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Une société pluridisciplinaire, de laquelle les préoccupations d’ordre environnemental n’ont jamais été absentes.
L’ensemble des communications présentées au congrès de Bagnères est regroupé selon l’intitulé des divers ateliers alors ouverts : Les données naturelles ; l’occupation de l’espace (archéologie et histoire) ; l’exploitation des ressources naturelles ; histoire et archéologie, forêts et pâturages ; les politiques de l’environnement ; découvertes et représentations. Soit six ensembles, que nous examinerons plus en détail.
Les données naturelles réunissent quatre exposés ; le premier, de Jean-Paul Crampe, qui appartient au Parc national des Pyrénées, sur la réintroduction du bouquetin ibérique dans les Pyrénées. L’espèce avait disparu des Pyrénées françaises au début du XIXe siècle et son extinction fut confirmée en 2000 dans le parc national espagnol d’Ordesa. L’expérience menée s’appuie sur les acquis de la restauration du bouquetin des Alpes. En 2014 et 2015, au cours de neuf opérations de lâcher au total, 63 bouquetins (26 mâles et 37 femelles) ont été ainsi libérés dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, sur le territoire de la commune de Cauterets (espace Péguère-Ardiden).
Autour de Sandra Malaval, ingénieur agronome, chargée de mission au Conservatoire botanique pyrénéen et d’autres membres, dont le directeur, Gérard Largier, a été présentée une étude sur la restauration écologique de la montagne à travers la valorisation de la diversité végétale pyrénéenne, à l’occasion des aménagements en altitude (terrassements, remaniements de terre et de roches, décapage de sols ) nécessités par les activités touristiques et sportives, en particulier sur le domaine skiable (nivellement de pistes, creusement de canalisations pour l’enfouissement des conduites des canons à neige, notamment). Ces travaux entraînent une destruction de la couverture végétale et une érosion importante qu’il faut combattre et compenser par une revégétalisation. Cette pratique est d’ailleurs ancienne, les populations montagnardes ayant l’habitude de restaurer les prairies en récoltant dans les greniers à foin les semences nécessaires. C’est ainsi que les pistes de la station de ski de Superbagnères furent revégétalisées à la fin du siècle dernier avec des graines recueillies dans des granges de la vallée d’Oueil. Parallèlement, des pratiques d’implantation de semences exogènes s’adaptant mal aux conditions écologiques des sites ensemencés, surtout en altitude, ou présentant des risques d’hybridation et de modification de la flore locale ont été écartées au profit de solutions vertueuses plus adaptées, tenant compte de la conservation de la flore et menées à l’échelle du massif pyrénéen, côté français, à travers le programme Ecovars et la création d’une marque collective de semences « Pyrégraine de néou », à l’image d’expériences au niveau international (Autriche, États-Unis) et qui a inspiré de semblables projets dans les Alpes (Alp’grain, Semences du Mont-Blanc).
Annie Souriau, directrice de recherches au CNRS, membre de l’Observatoire Midi-Pyrénées, Mathieu Sylvander et quatre autres chercheurs de l’observatoire, spécialistes de la sismicité pyrénéenne, font le point sur les séismes de la chaîne qui sont une donnée naturelle de ces montagnes et dont l’histoire offre des exemples prenant parfois des allures catastrophiques, aux XIVe (Val d’Aran), XVe (Catalogne), XVIIe (secteurs de Bagnères-de-Bigorre, de Lourdes et du Lavedan), XXe (Arette, Béarn) siècles ; ils mettent surtout l’accent sur les réseaux de surveillance mis en place et qui permettent de relever de l’ordre d’un millier de séismes par an, dont la plupart ont une faible magnitude (seuls de 10 à 15 sont perceptibles par les populations) , mais qui font des Pyrénées la région la plus sismique de France métropolitaine. Ces réseaux ont permis l’établissement d’une cartographie de plus en plus précise.
Dans la continuité de cette communication et dans une perspective plus historique, Jean-Luc Laffont, de l’université de Perpignan-Via Domitia rend compte du tremblement de terre bigourdan du 21 juin 1660, le plus important séisme de l’histoire pyrénéenne qui a laissé de nombreux témoignages, notamment rassemblés dans une précieuse banque de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) mise en ligne sur son site (sisfrance.net) et a donné lieu à une quarantaine de publications. L’auteur s’attache à présenter les diverses manifestations (bruit, secousses, durée, intensité, répliques), lieux de perception, effets (victimes et dégâts subis, effets sur l’environnement, bouleversement des montagnes et modifications du réseau hydrographique, sensibles dans ces régions de sources thermales). Il relève en revanche l’absence de témoignages sur les animaux, domestiques ou sauvages.
L’occupation de l’espace regroupe sept communications, quatre dans le domaine de l’archéologie, trois dans celui de l’histoire.
![]() Archéologie :
Archéologie :
La présentation d’une recherche en cours sur des campements ruraux de piémonts pyrénéens, de la Protohistoire à l’Antiquité, assurée par quatre archéologues de l’ITEM, de l’INRAP et de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour est précisée par les apports des SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) et montre pour le présent la diversité des critères d’implantation de ces sites archéologiques, leur relation avec des voies de transhumances modernes et médiévales ne pouvant plus être retenue comme fonction unique de ces lieux.
Quatre autres chercheurs ou doctorants de l’UPPA et de l’Université de Navarre examinent la fréquentation de grottes des Pyrénées occidentales espagnoles et françaises à l’époque de l’occupation romaine. Elle révèle une succession de fréquentations susceptibles de modifier des fonctions antérieures ainsi qu’un caractère d’habitat plus ponctuel que stable. Le mobilier retrouvé sur les sites est d’ordre métallique, numismatique et céramique (en particulier de nombreux fragments de lampes).
René-Pierre Domergue, collaborateur du Centro de estudios del Sobrarbe (C.E.S.) présente les premiers éléments d’une enquête sur l’habitat et le peuplement en Sobrarbe du VIe au XIIe siècles ; petit pays en haut Aragon, compris entre la Ribagorza à l’est, le Serrablo à l’ouest, les Pyrénées au nord et les sierras extérieures au sud, il a pour cours d’eau principal le rio Cinca et son climat de montagne est tempéré par des influences méditerranéennes. Son histoire ne bénéficie que de peu de travaux, car les sources d’archives font défaut et tout ce dont on dispose pour la période médiévale (chancellerie des rois d’Aragon, archives des évêchés et monastères dont celui de San Victorian) a déjà été publié. Pour cette étude sur le peuplement et les habitats divers, le corpus n’est que de 350 documents, dont beaucoup sont des faux postérieurs à la période considérée. Ces lacunes sont partiellement comblées par l’étude de la toponymie, la cartographie, la couverture photographique aérienne, les résultats de fouilles de sites médiévaux étant rares. Les résultats obtenus sont médiocres pour la période de l’Antiquité tardive (VIe siècle), alors que plusieurs sites du haut empire romain ont pu être localisés. Pour le haut Moyen Age (VIIIe-IXe siècles), on trouve la mention dans un texte d’un orreum (grenier à graines) situé dans une villa (terme pouvant être interprétée soit dans son sens antique soit dans celui de village ou de communauté d’habitants), indiquant la pratique d’une agriculture céréalière. On a aussi, non loin d’Ainsa des sites en hauteur, avec des restes de murs de pierre sèche. La toponymie révèle aussi quelques noms d’origine arabe. C’est après l’an Mil qu’on trouve une forte densité d’habitats et de peuplement, avec de nombreux villages et hameaux, ces derniers situés sur les pentes ou en bordure des terrasses et les terres cultivables devant être prioritaires, les chemins empiètent le moins possible sur celles-ci. On remarque aussi que la présence de l’eau potable n’est pas déterminante dans l’implantation des habitats, souvent assez éloignés du point d’eau mais que les maisons sont toutes équipées de citernes de récupération des eaux pluviales. La maison traditionnelle, la casa-patio, possède un étage réservé à l’habitation, un séchoir sous le toit tandis que le rez-de-chaussée est attribué aux animaux et à la cave. Les habitats sont soit semi-groupés, soit constitués de maisons mitoyennes. L’église est souvent située en bordure, voire à l’écart ou en position légèrement dominante. Dans les vallées principales, l’habitat est plus compact ou groupé, et les habitations sont situées de part et d’autre d’une rue unique ou réparties suivant un plan en damier. Dans le cas de la présence d’un château, le phénomène d’incastellamento, quand il existe, n’implique pas nécessairement que le village soit étroitement lié à la fortification. Quant aux monastères, ils n’ont pas laissé autour d’eux la trace d’un habitat de quelque importance. Associée au village, l’église n’en constitue pas le centre. Reste à mener une enquête pour savoir si la première mise en valeur médiévale de la terre s’est faite à partir du village à maisons. Le Sobrarbe a reçu son peuplement et sa mise en valeur les plus denses aux XIe et XIIe siècles, comme la plupart des pays de la chaîne pyrénéenne et ce jusqu’au mouvement d’exode rural ; pour les périodes plus anciennes, il reste encore beaucoup de recherches à mener.
Florence Guillot, chercheuse associée au CNRS Traces-terrae a étudié la mise en place de l’habitat en haute et basse vallée de l’Ariège du Xe au XIVe siècle, dans une zone de circulation majeure suivant un axe Ax-les-Thermes-Tarascon-Foix-Varilhes-Pamiers-Saverdun. Elle a séparé sa recherche en deux ensembles, la haute et la basse vallée de l’Ariège, qui, réunies, comptent environ deux cents communes. Séparation nullement artificielle, tant il existe de dissemblances s’agissant des types de peuplement, des activités économiques et de la répartition de l’habitat. La haute Ariège au sud, comporte de 70 à 80% de villages « à maisons », avec un peuplement montagnard et une économie sylvo-agro-pastorale alors que la basse Ariège n’en a apparemment pas. Elle donne comme exemple Sentenac, en haute vallée du Vicdessos, qui est un village casalier (ou village à maisons) groupé sur une soulane, avec une église préromane située, avec son cimetière, à l’écart du village. Abstraction faite de ces villages à maisons, l’habitat des hautes vallées ariégeoises au Moyen Age est presque totalement un habitat groupé et répond à divers types de peuplement : les villages castraux sont rares ; Ax (Ax-les-Thermes) et Tarascon (aujourd’hui Tarascon-sur-Ariège) étaient à l’origine des villages castraux comtaux, devenus centres commerciaux dont le développement date des XIIIe-XIVe siècles. Foix, d’abord bourg monastique, puis castral, n’avait au milieu du XIIe siècle que cinq à six rangées de maisons autour de l’abbaye Saint-Volusien et du château comtal. En haute Ariège, les résidences seigneuriales étaient aussi situées près des habitats préexistants, contrairement à la basse Ariège où on les trouve isolées. De même, en plaine et dans le piémont, les habitats médiévaux furent peu ou pas groupés, l’église et le cimetière demeurant le lieu de concentration de la paroisse.
L’urbanisation des communautés d’habitants à la fin du Moyen Age est liée au développement des échanges, et à l’abandon en période de crise des espaces montagnards au profit de la plaine et du piémont. Elle entraîna une croissance des villages castraux jusqu’au milieu du XIVe siècle, tel Saverdun, avec l’apparition de nouveaux quartiers. Elle eut aussi comme manifestation la fondation vers le milieu du XIIIe siècle de bastides en paréage entre le comte de Foix et des abbayes, réalisations le plus souvent fortifiées. Apparut également pendant la guerre de Cent Ans le phénomène des forts villageois ou la remise en défense de castra anciens.
![]() Histoire :
Histoire :
Stéphane Abadie, enseignant, docteur en histoire médiévale et président de la Société académique des Hautes-Pyrénées, présente une communication sur les « bastides rurales » du comté de Bigorre, qui peuvent apparaître, au premier examen et en regard des bastides urbaines comme des « bastides ayant échoué », restées à l’état d’espace rural. Or ces dernières peuvent avoir constitué des opérations de remembrements agraires suivant des parcellaires parfaitement planifiés, mettant en valeur économique un territoire. L’auteur, écartant de son sujet les bastides urbaines bigourdanes du XIVe siècle bien connues (Rabastens-de-Bigorre, Tournay, Trie-sur-Baïse) donne cinq exemples de ces bastides « rurales » des XIIIe-XIVe siècles : Réjaumont (1285) qui est issue de la transformation des terres d’une grange monastique dépendant de l’abbaye de l’Escaladieu en opération de remembrement, avec constitution d’un parcellaire régulier ; Sère-Rustaing (1310) et Sarrouilles (1324) qui offrent toutes deux un terroir à parcellaire régulier ; Aveas, Cartan (ou Carsan) et Usac (1305), paréage de terres entre l’abbaye de l’Escaladieu et la comtesse de Foix, dame de Nébouzan, dont on trouve sans doute des traces sur le cadastre de la commune d’Avezac-Prat-Lahitte (canton de la Barthe-de-Neste) ; enfin, Saint-Luc (1322), commune actuelle de Lubret-Saint-Luc, où l’espace « urbain » a entièrement disparu mais où le parcellaire régulier est bien conservé. Tous ces exemples présentent des caractères communs : ils sont le résultat de paréages, qui proposent aux nouveaux habitants « poblans » un terrain à bâtir et des terres à cultiver, dans la perspective de peupler un espace rural avec des agriculteurs, une « colonisation » rurale sans véritable volonté de bâtir un village aggloméré ou ayant finalement débouché sur une urbanisation avortée.
Anne Berdoy, docteur en histoire médiévale, attachée au FRAMESPA, Université Toulouse 2-Jean Jaurès, étudie le tissu ecclésiastique du Haut-Béarn au Moyen Age, à travers le cas des chapitres de Laruns et de Borce au XIIIe siècle, soit un exemple en vallée d’Ossau et un en vallée d’Aspe. Les sources d’archives demeurent maigres pour cette partie du diocèse d’Oloron. Cette notion même de « chapitre » est assez floue, car dans les deux cas précités on ne trouve pas la présence d’une collégiale ou d’une abbaye ; on pourrait retenir plutôt l’hypothèse d’une assemblée de prêtres, chapelains, prébendiers, ou d’un conseil d’ecclésiastiques siégeant en réunion. En Bigorre et Lavedan, le phénomène des fadernes, étudiées par Jacques Poumarède, est connu et on trouve d’autres communautés de prêtres en divers endroits des Pyrénées centrales, comme l’a récemment montré Serge Brunet (Les Prêtres des montagnes). Toutefois, ces communautés ont été surtout bien examinées pour l’époque moderne. Le diocèse d’Oloron ne dispose pas de document permettant d’avoir une vue d’ensemble sur son organisation et son clergé, sur l’existence de lieux de culte, dont certains ont disparu, et qui ne sauraient être réduits à la seule église paroissiale. La toponymie, la présence ou non d’une abbaye laïque offrent des pistes pour en établir la liste, comme par exemple, sur la commune d’Espalungue, la mention d’un lieu la gleisiette est la seule trace subsistante d’une église « Saint-Saturnin » qui était au XVe siècle l’église de la paroisse. De même, alors que coexistaient au XVIe siècle deux abbayes laïques sur la commune de Gètre, il ne reste rien d’une église forcément présente en ce lieu à cette époque. A Gabas existait au XIIe siècle un prieuré dépendant du monastère-hôpital de Sainte-Christine du Somport ; subsiste aujourd’hui une chapelle correspondant à l’ancienne église de la Sainte Trinité de ce prieuré. A Borce, une maison sur le cadastre de 1837 est dite Lagleise ou Lagleisiette, exprimant sans doute la présence d’un ancien lieu de culte à cet emplacement. La collecte demeure partielle et ne produit souvent que des indices, mais elle reflète la présence d’un tissu ecclésiastique correspondant aux lieux de peuplement anciens.
Eric Fabre, maître de conférences habilité, de l’université Aix-Marseille, examine la notion de piémont, « non-concept géographique devenant concept historique » et compare piémont pyrénéen et piémont des Alpes du Sud, du XVIIIe au XXe siècle. Le piémont, espace transitoire entre la montagne et la non-montagne, en combine les influences. A partir d’une étude monographique sur une région des Alpes du Sud, comparée avec une région du versant nord des Pyrénées, entre Aude et Ariège, il met l’accent sur un piémont demeuré aux marges des espaces étudiés, pour lequel les travaux publiés sont peu nombreux ou très spécialisés. Zone d’échanges, tel apparaît le piémont ariégeois, avec des villes-relais comme Tarascon.
Venue de Catalogne, la laine alimente l’industrie textile de Foix, du pays de Limoux ou de Carcassonne, qui est un centre producteur de draps. Le bois des sapinières du pays de Sault est transformé autour de Puivert, des scieries de Rivel et sert à la fabrication de comportes pour le transport du raisin et des grains. Les foires de Mirepoix sont un lieu de vente de bovins exportés vers le Lauragais et le pays toulousain. Lavelanet possède des foires aux mules et mulets. Bélesta est un centre d’échanges entre plaine et montagne. Quillan est un port pour le flottage des sapins du pays de Sault vers la Méditerranée. Au 17e siècle, on note un phénomène de rétractation du piémont que la forêt du pays de Sault en exploitation envahit en s’étendant vers la plaine, faisant disparaître des hameaux et métairies éparses.
L’amélioration ultérieure des voies de communication mettra fin au rôle de centres marchands de bourgs comme Bélesta. Au XIXe siècle, la liaison plaine-montagne alors en progrès effacera ainsi les relais locaux, effacement qu’accentuera l’arrivée du train dans ces zones au début du siècle dernier. La désindustrialisation de ce piémont fera disparaître son rôle de relais et appauvrira son peuplement par suite de la suppression d’activités ouvertes à une main d’œuvre locale.
Dans les Pyrénées comme dans les Alpes, l’étude des espaces intermédiaires que sont les pays de piémont aboutit aux mêmes conclusions. Ces piémonts ont des caractères physiques communs : des reliefs parallèles à la montagne, moins élevés et creusés de sillons, où des rivières créent des bassins qui sont aussi des bassins de vie. De petites villes y remplissent des fonctions transversales entre montagne et autres reliefs, longitudinales le long de la montagne. La baisse démographique y entraîne la réduction de l’activité des exploitations et l’expansion des villes de plaine ou du littoral, une émigration définitive. Ces piémonts sont un espace intermédiaire apte à tout quand domine l’autoconsommation et bon à rien dans un cadre de plus en plus commercial, avec un développement industriel dans la plaine et près des villes d’où résulte une désindustrialisation rurale. Pour Eric Fabre, les XIXe et XXe siècles sont l’époque de la « mort des piémonts », alors que les deux siècles précédents avaient été ceux de leur plein développement.
L’exploitation des ressources naturelles comprend quatre communications.
Michel Martzluff et trois autres chercheurs de l’Université de Perpignan-Via Domitia étudient les marbres rouges des Pyrénées et leur utilisation dans l’architecture depuis l’Antiquité et examinent successivement les marbres dévoniens du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne et leurs différents sites, les marbres bréchiques du Cénozoïque des Corbières et fournissent une documentation photographique d’échantillons. Ils montrent comment les marbres colorés des Pyrénées orientales ont été utilisés sous l’Antiquité, à travers diverse exemples de fouilles archéologiques, à Prades, à Perpignan, près de Caramany, dans le Fenouillèdes, à Corneilla-del-Vercol, dans le Roussillon, sur un site wisigothique à Estagel, dans la partie roussillonnaise des Corbières, sites divers sur lesquels ont été mis au jour des blocs de marbre, des fragments de colonnettes et leur base, des fragments de chapiteaux.
Richard Sabatier, architecte et enseignant en architecture, membre de la Société Ramond, présente les premiers résultats de l’étude à développer d’un aqueduc antique dont l’existence était connue depuis 1878, date de sa première et brève exploration, mais qui fut mis au jour en 2014 à l’occasion de travaux de voirie dans le quartier thermal de Bagnères-de-Bigorre. Avec l’autorisation du conservateur régional de l’archéologie, la prospection de cet aqueduc doit être assurée par la Société Ramond, représentée par Richard Sabatier, avec le concours d’archéologues professionnels et de laboratoires de l’UPPA et de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes.
Véronique André-Lamat, Isabelle Saccareau (Universités Bordeaux 2-Victor Segalen 3- Michel de Montaigne et CNRS) et Serge Briffaud (mêmes institutions et Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux) présentent une communication sur la mise en paysage de l’énergie dans les Pyrénées centrales, ayant pour objet la relation entre le tourisme et l’hydroélectricité et montrant qu’à diverses périodes, les logiques industrielles et les logiques touristiques ont convergé pour contribuer à produire les paysages pyrénéens que nous connaissons. Soit « une convergence d’intérêts entre promoteurs de la houille blanche, investisseurs touristiques et compagnies de chemins de fer » pour la conquête des montagnes pyrénéennes. Pour rendre plus accessible la montagne aux touristes et curistes des stations thermales (qui s’y rendaient auparavant par la route), on a développé la traction électrique pour les tramways reliant les stations thermales du cœur de la montagne au réseau de piémont et pour cela, on a construit des centrales électriques alimentées par la « houille blanche » grâce aux barrages et aux captages par conduites forcées. Deux exemples : Cauterets et Luz-Saint-Sauveur, reliés par tramway à la ligne Pierrefitte-Lourdes-Tarbes (1898) ; la ligne touristique de tramway Lourdes-Bagnères-Gripp (1914) permettant aux curistes et aux pèlerins de découvrir la vallée de Campan et d’aller en excursion jusqu’au pied du Pic du Midi. Autre usage : éclairer électriquement les hôtels et casinos des stations thermales. Cauterets se dote ainsi dès 1896 de l’éclairage électrique qui remplace le gaz. Et ce mouvement va être suivi par des initiatives d’hôteliers situés à l’écart des villes et aménageant leurs propres centrales électriques privées. Au cours du XXe siècle, l’exploitation de la houille blanche change de mode et d’échelle. Aux captages succèdent entre 1920 et 1950 les lacs de barrage (existait déjà celui d’Orédon, pour alimenter le canal de la Neste) : Artigues (1921) ; barrage de l’Oule (1911-1923) ; barrage de Gèdre (1927) ; barrage d’Aubert (1932) ; barrage des Gloriettes (1948-1952) ; barrage de Cap-de-Long (1950-1953). Les routes d’accès à ces barrages et à leurs lacs de retenue ouvrent aussi la voie de la haute montagne aux touristes et à leurs automobiles. Aux téléphériques des chantiers d’altitude vont succéder avec l’aménagement des stations de ski les téléphériques desservant les pistes. A Cauterets, celui du Lys est ouvert en 1936. A Barèges, c’est le funiculaire du Lienz qui est construit en 1936-1937 et celui de l’Ayré, en 1949. Au cœur de ce mouvement d’électrification, deux éléments emblématiques du paysage pyrénéen se détachent : la cascade et le lac, qui représentent tous deux un potentiel énergétique naturel. Les grandes cascades, à Cauterets et surtout à Gavarnie sont de grandes destinations touristiques qui offrent une image dynamique là où la surface des lacs de montagne est un élément apaisant. Et dans l’aménagement de la montagne à des fins touristiques, l’ingénieur joue un rôle important, avec la réalisation d’ouvrages d’art, centrales électriques, barrages qu’il s’efforce de rendre esthétiques et dignes d’admiration comme ceux d’Orédon et de Cap-de-Long qu’on vient contempler, qui s’intègrent au paysage et incarnent les apports de la civilisation à un environnement resté jusque-là sauvage.
Après la seconde guerre mondiale l’aménagement hydraulique de la montagne et le développement du ski modifient plus amplement encore le paysage. En témoignent le système colossal de la centrale de Pragnères avec le pompage des lacs du massif du Néouvielle d’un bassin versant à un autre et l’urbanisation en altitude, avec les stations de ski qui se développent après 1945 et jusqu’en 1980 : La Mongie, Le Pla d’Adet-Saint-Lary-Soulan, Luz-Ardiden, Gèdre-Gavarnie, Piau-Engaly dont les remontées mécaniques toujours plus performantes et les appartements touristiques sont alimentés en électricité produite par les centrales, cependant que le développement de la neige de culture va puiser à la ressource en eau des lacs de barrage. Des domaines skiables sont constitués, sans respect pour la logique territoriale des vallées, comme l’ensemble du grand Tourmalet (Barèges-La Mongie).
Dans les années 1960-1970 en réaction avec l’aménagement souvent anarchique des stations de ski, un plus grand respect de l’environnement va s’imposer, avec la définition de normes et de règles ordonnant désormais la relation de l’homme avec la nature et la création de zones protégées d’où l’homme est exclu. Ainsi est créé en 1967 le parc national des Pyrénées, dans la suite de celui de la Vanoise dans les Alpes (1960). Il empêche tout nouveau projet hydroélectrique sans remettre en cause les équipements existants et sanctuarise les espaces d’altitude encore vierges. Quant aux aménagements en place, ils sont intégrés aux activités touristiques et sont perçus comme des éléments du patrimoine, comme la centrale de Pragnères dont l’architecture industrielle de qualité fait l’objet de visites guidées. Des circuits de randonnées sont formés autour des lacs de barrage. Toutes ces infrastructures sont devenues au fil du temps des buts de promenade.
Jean-Christophe Sanchez, agrégé et docteur en Histoire, vice-président de la Société Ramond, chercheur associé (FRAMESPA-UMR 5136, Université Toulouse 2-Jean Jaurès) étudie le Mémoire sur les eaux minérales et les établissements thermaux des Pyrénées, attribué à Lomet et qui est en fait en grande majorité l’œuvre de Ramond de Carbonnières. Son contenu manifeste une perception et une pensée novatrice de l’espace montagnard. Ramond, alors détenu à Tarbes en pleine Terreur, sera en quelque sorte sauvé de la guillotine par la commande qu’il reçoit de travailler à ce mémoire. Celui-ci fait le point sur le thermalisme haut-pyrénéen dans la décennie 1790. Initialement limité à Barèges, il est enrichi par Ramond d’observations sur les sites de Saint-Sauveur et de Cauterets. Ramond y préconise des mesures pour protéger la qualité des eaux. Il propose aussi des solutions pour la prévention des risques naturels, crues et avalanches, essentiellement à Barèges. Pour ces dernières, un reboisement méthodique, utilisant différents essences, apparaît nécessaire, ainsi que l’aménagement de bastions en pierre sèche comme dans les Alpes. En matière de thermalisme, il propose pour les établissements de bains une architecture de qualité, notamment pour Barèges et pour Bagnères-de-Bigorre, un grand établissement (qui ne verra le jour que sous la Restauration). Le tout avec un souci d’aménagement des abords par des plantations, des promenades. Les voies d’accès aux stations thermales devront être améliorées, comme sur le tracé de Pierrefitte à Luz où les communications sont « sans cesse menacées par les accidens d’une nature puissamment active » (question toujours d’une brûlante actualité !)
Histoire et archéologie, forêts et pâturages est un thème qui réunit trois communications.
René Escafre, président de la Société d’étude des Sept Vallées présente une étude sur la faux, outil de la fenaison, « outil emblématique de la culture européenne », qu’il décrit de façon détaillée, avec ses outils auxiliaires nécessaires à sa maintenance et dont il fait l’historique ; il montre comment l’usage de la faux façonne l’espace montagnard, avec ses prairies naturelles qu’il convient de préparer pour en ôter toutes les pierres, lesquelles vont servir à élever les murettes des enclos pour les brebis ou à construire les étraves de protection des granges contre les avalanches, comme à Saugué, en vallée de Barège.
Mélanie Le Couédic, de l’UPPA et un groupe de quinze chercheurs de l’UPPA, des Universités Paris I et Toulouse 2 Jean Jaurès, ainsi que catalans, aragonais, andorrans présentent le projet « DEPART » (Dynamiques des Espaces Pyrénéens d’Altitude), créé en 2014, dont l’objectif est « d’appréhender les processus de changement des systèmes d’exploitation des zones d’altitude à différentes échelles d’espace et de temps », à travers une douzaine d’ateliers répartis sur les deux versants de la chaîne pyrénéenne. Les équipes se connaissent et échangent depuis longtemps ; elles s’appuient sur un socle thématique, épistémologique et méthodique commun. Au cours de deux décennies de travaux, un très important corpus de sites pastoraux s’est constitué. Le projet comprend la création d’une base de données sous système d’information géographique (SIG) permettant des comparaisons, en partant d’une expérience menée sur un échantillon du corpus. Le second objectif est de formaliser des modèles destinés à permettre des comparaisons, dans le cadre d’une interdisciplinarité élargie. Que doit-on retenir pour comparer les processus de structuration de l’espace pastoral montagnard ? A quelles échelles, sur quelle durée et à partir de quelles sources d’information et de quels modèles ? Au cœur de cette recherche, une dimension archéologique, composée d’environ 500 nouveaux sites pastoraux (cabanes, grottes, enclos) et pour commencer, un état des lieux et une comparaison des bases de données existantes, avec la constatation d’une grande hétérogénéité des données recueillies (types de sites, diversité des constructions, époques, environnements naturels). Quelques caractères ont pu être dégagés : les structures de parcage sont plus petites à l’ouest de la chaîne que dans sa partie orientale. De grandes différences existent dans les modes d’association des structures (imbriquées ou accolées, ou très dispersées). Les indices d’occupation sont variables, en majeure partie des constructions ou abris naturels, ou des concentrations de mobilier. La définition de la problématique et du rôle du SIG a conduit a définir les périmètres géographique (altitude et localisation) et chronologique et la thématique (objets pris comme éléments de connaissance et relations entre eux). On est ensuite passé à la modélisation du SIG (identification de l’information ; conception du modèle). La base retenue a été la structure (cabane, enclos, cavité naturelle) comme élément de localisation, au sein de laquelle se rattachent les occupations successives. Occupations et structures constituent des établissements pastoraux, comprenant une ou plusieurs structures. Aux occupations est rattachée la chronologie, avec la mention des sources de la datation.
Jean-Paul Métailié, directeur de recherches au CNRS, GEODE-UMR 5602, Université Toulouse 2-Jean Jaurès et quatre autres chercheurs de la même unité de recherche étudient les sapinières du Volvestre (Ariège et Haute-Garonne). Alors que le sapin du versant nord des Pyrénées pousse entre 800 et 1000 mètres d’altitude, les sapinières du Volvestre, éloignées de la chaîne, dans les collines du piémont, sont positionnées entre 350 et 450 mètres d’altitude et sont une anomalie. Elles constituent en effet un des peuplements de cette essence les plus bas sur le territoire français, qui a soulevé plusieurs questions sur leur origine. S’agit-il d’un refuge glaciaire ou d’une plantation due à des moines de l’abbaye de Sainte-Croix, de l’ordre de Fontevrauld (fondée vers 1114-1117), au XIIe siècle (forêt de Sainte-Croix-Volvestre, 200 ha) ? Une seconde forêt de sapins, d’origine seigneuriale, est celle de Montbrun-Bocage (140 ha). Ces deux sapinières assez proches l’une de l’autre (3,5 km) se trouvent plantées dans des conditions assez similaires, entre 300 et 500 m, avec la même orientation ouest-est et sur des sols de grés et de marnes. La forêt de Sainte-Croix fut visitée par Froidour en 1667, lors de la grande réformation des forêts et arpentée un an plus tard. Elle couvrait alors 171 ha, en futaies de hêtre et de chêne, en broussailles au nord et pour sa moitié sud, en sapin. Au XIXe siècle, le sapin est aussi présent dans sa moitié nord. La forêt de Montbrun est, au milieu du XVIIIe siècle plantée de chênes et de hêtres à l’est et au sud et de sapins dans sa partie ouest. Le châtaignier apparaît à la fin du XIXe siècle dans les clairières. Elle est partagée entre propriété privée (le seigneur), bien exploitée et propriété de la communauté, plus dégradée, mais avec une progression du sapin. Ces deux forêts ont évolué assez semblablement : présence des sapinières, exploitées pour le bois d’œuvre et la mâture ; surexploitation en divers points, avec apparition de taillis et de clairières.
On peut donc remarquer que la présence du sapin, bien constatée sous l’Ancien Régime, n’est pas récente et ceci est confirmé par les apports de l’étude palynologique et pédo-anthracologique, qui révèlent son implantation dès le Néolithique et sa vitalité au Moyen Age, puis sa pérennité, voire son extension au cours des trois derniers siècles.
Cinquième volet du congrès, Les politiques de l’environnement : actions et réactions regroupent trois communications.
Serge Briffaud et Emmanuelle Haulmié (UMR PASSAGES-CNRS/ Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux) examinent, à partir du cas de Gavarnie, les politiques du paysage et les mutations socio-spatiales de la montagne pyrénéenne confrontée à l’expansion de l’hydroélectricité. Le Cirque de Gavarnie a été classé en 1921, protection étendue par étapes (1930, 1941) aux cirques voisins d’Estaubé et de Troumouse et aux vallées de Campbielh et d’Ossoue. Les auteurs posent plusieurs questions : comment concevait-on dans les premières décennies du siècle dernier la notion de protection du paysage ? Quels étaient les enjeux du classement du site de Gavarnie ? Quels étaient les éléments de mobilisation en faveur de ce lieu, en réaction à des menaces éventuelles (projets d’exploitation hydroélectrique) pouvant peser sur son intégrité ?
La contemplation de la nature et des paysages liée au cours du XVIIIe siècle à la découverte des Pyrénées, trouve en matière de préservation ses applications concrètes dans la seconde moitié du XIXe siècle grâce à la mise en place d’une législation sur le reboisement, le gazonnement et la restauration des terrains en montagne et la création pour ce faire de périmètres domaniaux. Si le reboisement généralisé fut un échec par suite de la résistance des populations, des succès notables furent enregistrés dans les secteurs les plus touristiques : reboisement du Péguère, à Cauterets, opérations de reboisement à Gavarnie. En outre, avec la Première Guerre mondiale, la pression des habitants sur la ressource agro-sylvo-pastorale tendit à diminuer, alors qu’émergeaient les premiers projets de réserves naturelles, de parcs nationaux et que les grands pyrénéistes et les promoteurs du tourisme faisaient entendre leurs voix en faveur de la protection des paysages. Dans le cas de Gavarnie, la levée des défenseurs résulta des projets d’exploitation hydroélectrique du site liés à un accord sur la ressource en eau avec la Commission syndicale de la Vallée de Barèges (CSVB) ; cette défense prit une dimension nationale et mobilisa même des écrivains alors célèbres, comme Pierre Loti et des associations comme le Club Alpin Français (CAF), le Touring Club de France (TCF) ou la Société pour la Protection des Paysages de France (SPPF) pour aboutir après le conflit au classement de 1921. Les communicants exposent l’affaire du lac de La Prade (ou lac du Marboré), soit l’idée de réaliser un plan d’eau avec barrage au Cirque de Gavarnie, qui constituait un contre-projet à la construction de routes à péage dans le secteur Gèdre-Gavarnie, dont le plus grand détracteur était Louis Le Bondidier, fondateur du Musée pyrénéen du château-fort de Lourdes et inspirateur du projet de lac. Attitude contradictoire avec l’opposition précédente à toute utilisation de l’eau des torrents, mais mise en avant par des arguments d’ordre esthétique et touristique. Arguments propres à une petite élite de pyrénéistes issus des villes et s’érigeant en aménageurs du territoire pyrénéen car seuls détenteurs de la vérité face aux ruraux de la Commission syndicale de la Vallée. La Seconde Guerre mondiale vint mettre un terme à tous ces projets.
David Penin et Eric Sourp (Parc national des Pyrénées) font le point sur 50 ans de recherches scientifiques au Parc, développées à partir de son conseil scientifique. En effet, à l’origine, le Parc limitait son activité à des suivis de la faune (populations d’isards, de vautours fauves, de grands tétras) et externalisait les études dans des laboratoires de recherche. Les agents du Parc assuraient seulement la logistique et servaient d’accompagnateurs des chercheurs sur le terrain. Progressivement, ces agents, mieux formés, vont participer plus directement aux inventaires floristiques et faunistiques et aux travaux de cartographie. En 1982, un premier noyau de service scientifique est mis en place. Deux en plus tard, une commission scientifique est établie. Une politique de protection des richesses naturelles et de protection de la zone centrale du Parc est affirmée comme prioritaire dans le programme d’aménagement 1981-1985 et demeurera une priorité des programmes d’aménagement successifs. La création du Conservatoire botanique pyrénéen avec ses programmes de connaissance de la flore et le développement de la politique Natura 2000 vont renforcer la montée en puissance de la recherche par un service scientifique structuré et compétent au sein du Parc, collaborant également avec l’université. Ce service va étendre progressivement son champ de recherches.
Une première phase avait été consacrée à la mise en place de protocoles d’inventaire, qui furent ensuite associés à la constitution d’un SIG. Ils portaient sur la grande faune, avec une base Isard et un comptage. D’autres bases spécialisées pour des espèces étudiées suivirent (ours, vautours, ongulés, chiroptères, batraciens, etc.) Dans les années 2000, l’effort porta sur l’inventaire d’espèces et la cartographie d’habitats et d’espèces à prendre en compte au niveau européen. Vint le tour d’une base flore, créée en 1995 dans le contexte du projet de création du Conservatoire botanique qui ouvrit ses portes en 1999. Une activité botanique fut cependant maintenue au sein du Parc.
La veille et le suivi de la faune jugée prioritaire furent entrepris peu après la création du Parc et permettent de disposer aujourd’hui d’une vision sur le long terme, comme pour l’isard et le vautour fauve. De même, l’évaluation des dommages générés (par exemple, par les sangliers). En 2002 d’autres veilles furent actionnées pour d’autres espèces (chiroptères, loutre) et abandonnées ensuite quand la colonisation totale d’une espèce fut constatée (cas de la loutre).
Le suivi de la flore n’a débuté qu’en 1999, principalement sur 24 espèces rares et endémiques.
A noter aussi des suivis d’habitats naturels (tourbières, pâturages abandonnés, évolution des glaciers), la recherche de la conservation des zones humides du Néouvielle (depuis 2009) et la réflexion autour des protocoles de suivis scientifiques de ces zones, des tourbières, des pelouses.
Cette recherche autour de la connaissance des milieux naturels a été accompagnée d’actions de connaissances des activités socio-économiques (comme la fréquentation touristique de la zone centrale du Parc et de la Réserve du Néouvielle) et de soutien de recherches sur l’histoire humaine de ce territoire (comme l’archéologie pastorale ou la réalisation d’inventaires du petit patrimoine vernaculaire, en collaboration avec les CAUE, aboutissant à des publications vallée par vallée proposées au public et à leur intégration dans le SIG.
Le Parc a également collaboré à la réalisation d’un projet inter-parcs d’atlas.
Depuis la loi de 2006 et la réalisation des chartes, le Parc national et ses habitants sont placés dans un lien privilégié. Mais la crise a entrainé une diminution des moyens humains et financiers, donc une baisse des capacités d’action, à compenser par des mutualisations et des partenariats. Le bilan des actions de connaissance traduit des faiblesses et des lacunes thématiques, des méthodologies de collecte des données pas assez solides et une prospection inégale sur certains secteurs éloignés ou difficiles d’accès. En 50ans, un travail considérable a cependant pu être entrepris et la connaissance du territoire du Parc est assurément bien meilleure qu’à l’époque de sa création.
Jean-Bernard Sempastous, maire de Bagnères-de-Bigorre et membre du conseil d’administration de la Société Ramond, Bernadette Dussert Peydabay, adjointe au maire chargée de la Culture et Philippe Serre, coordinateur-Réseau Education Pyrénées Vivantes/LPO France présentent un projet de « Muséum des Pyrénées » à Bagnères.
Depuis le XIXe siècle, Bagnères dispose de riches collections d’histoire naturelle, regroupées à la fin de ce siècle en un Muséum municipal. Dans les années 1970, grâce à l’impulsion donnée par Philippe Mayoux, professeur agrégé de sciences naturelles, naturaliste et vice-président de la Société Ramond, un renouveau du Muséum prend corps, par des expositions photographique et thématiques et la réalisation d’une grande maquette topographique du Haut-Adour. Depuis, malgré l’entrée d’une remarquable collection d’échantillons de marbre, ce Muséum est de nouveau en sommeil et la Ville, dans une démarche globale de mise en valeur de ses richesses naturelles et historiques, souhaite sa dynamisation et sa valorisation, le tout dans le cadre du vallon de Salut, site naturel classé, qui accueille à la fois le Conservatoire botanique national des Pyrénées (et de Midi-Pyrénées) - qui abrite aussi dans un de ses greniers une colonie protégée de chauve-souris, le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE) et le Muséum. En 2007, un rapprochement a lieu entre le réseau transfrontalier Education Pyrénées Vivantes créé dix ans plus tôt et la Ville de Bagnères et le projet de Muséum des Pyrénées émerge. En 2009, un groupe de travail est constitué. En 2010, une convention de partenariat entre le réseau et la Ville est signée. En 2013-2014, une exposition de préfiguration « Becs et ongles » est présentée au public. Le Muséum à naître est un projet de territoire (Bagnères et la communauté de communes, ainsi que le massif) fédérateur, impliquant acteurs locaux et extérieurs, envisageant des partenariats, notamment avec le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, pour la gestion des collections. Il sera formé de deux systèmes :
![]() Le Muséum, zone cœur, comprenant le Vallon de Salut et l’ensemble bâti avec une répartition de la superficie de présentation à 55% pour une exposition permanente traitant de l’histoire naturelle du massif et à 45% pour les expositions temporaires ;
Le Muséum, zone cœur, comprenant le Vallon de Salut et l’ensemble bâti avec une répartition de la superficie de présentation à 55% pour une exposition permanente traitant de l’histoire naturelle du massif et à 45% pour les expositions temporaires ;![]() Le Muséum « éclaté », à l’échelle du massif pyrénéen, formant un réseau.
Le Muséum « éclaté », à l’échelle du massif pyrénéen, formant un réseau.
Le projet aura pour objet de présenter une offre scientifique et culturelle évolutive du massif.
Dernière partie, Découvertes et représentations, particulièrement fournie et qui rassemble neuf communications.
Claudio Aventin-Boya, du Centre d Estudis Aranesi, présente, en Aranais (avec la traduction française) une recherche sur les premiers voyageurs dans les Pyrénées aranaises du XVIe au XVIIIe siècle. Le Val d’Aran, entre deux grands états, France et Espagne, trois régions et langues (Occitanie, Aragon et Catalogne), petit pays peuplé depuis la préhistoire et à l’époque de l’occupation romaine, dont témoignent des sources épigraphiques, où l’on parle aussi bien occitan, catalan que castillan et où beaucoup d’habitants comprennent aussi et pratiquent le français, fut exploré au cours de l’Ancien Régime et, dans le domaine historiographique, il subsiste beaucoup de témoignages et récits historiques. Compilations historiques générales, annales (comme celles de Zurita), récits de miracles dans les monastères, agendas catalans, cartographie, iconographie ; ou provinciales (et départementales) ou locales ; récits de fonctionnaires (Froidour) ou de militaires (ingénieurs et cartographes) ; visiteurs royaux et religieux, qui décrivent cette contrée et rendent compte de la vie quotidienne du clergé paroissial. On peut citer la relation au roi Philippe III de Gracia de Tolba, publiée plusieurs fois, notamment en 1889 dans le Bulletin de la Société Ramond. Ou encore les écrits de Zamora. Les rapports de divers religieux comme le jésuite Forcaud en 1642. Enfin, les scientifiques, comme Palassou, Arthur Young, Ramond dans ses Observations faites dans les Pyrénées (1789), et le naturaliste Saavedra (Descripcion fisica, civil y militar de los montes Pirineos, 1794) dont le mémoire est demeuré inédit jusqu’en 2008. Le texte d’Aventin-Boya, avec sa traduction, est complété d’une bibliographie.
Philippe Guitton, membre du conseil d’administration de la Société Ramond revient sur l’édition qu’il a donnée en 2014 de la thèse inédite d’Henri Lefebvre sur Les Communautés paysannes pyrénéennes pour examiner la place assignée au pastoralisme dans les sociétés pyrénéennes. Henri Lefebvre voit dans le pastoralisme l’élément fondateur de la structuration des sociétés pyrénéennes et insiste sur le rôle de la Véziau comme la forme d’organisation politique de la communauté pastorale. La cellule de base est la maison, dont la continuité familiale est soigneusement préservée au fil du temps, sans partage possible, d’où le strict maintien du droit d’aînesse, étendu aux filles. « L’héritier(e) de la maison » en est le chef.
L’économie pastorale est régie par un ensemble de droits : de dépaissance (faire paître en faisant passer le troupeau sans s’arrêter) ; de gîstre (passer la nuit, mais à la belle étoile) ; d’acabaner (construire des cabanes) ; le respect des limites (nombre de conflits en résultent ; la possession de la terre ; les libertés individuelles garanties (service militaire limité, libre mariage, non reconnaissance du servage) ; la défense des coutumes et chartes de la communauté contre les seigneurs et le roi ; droits politiques (la communauté est gérée par des jurats ou consuls) ; droits de justice (par exemple, le droit de pignorer, saisie directe, mais sous contrôle de la véziau ou des voisins, qui sont là pour constater, du bétail divagant).
Lefebvre examine les différences géographiques dans l’organisation des sociétés pastorales, en Catalogne, au Pays Basque, en Ariège et dans le Comminges ; en Béarn et Bigorre, où il voit le modèle le plus achevé d’organisation sociale et de gestion encadrée de la montagne, de l’irrigation, des enclos à bétail, de réglementation de la transhumance et de la gasailhe et en certains endroits, comme la vallée de Campan, une certaine souplesse accordée aux cadets pour les laisser défricher des lopins et devenir propriétaires, sans pour autant être au même niveau que les chefs des maisons casalères. Lefebvre étudie l’évolution historique des communautés et de la véziau mais il interrompt son examen à la Révolution. Il s’intéresse aussi aux dimensions mythologiques et théologiques des sociétés pyrénéennes, évoque les dissidences et résistances des Pyrénéens. Demeuré longtemps inédit et très peu accessible pour les chercheurs, le travail de Lefebvre n’a pas empêché le développement, hors de ses idées, de la recherche historique sur la vie des communautés pyrénéennes et sa lecture, comparée avec des travaux plus récents, doit permettre de confirmer ou d’infirmer ses théories.
Jean-François Rodriguez, architecte, enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, membre de PASSAGES-UMR 5139 du CNRS, étudie le cas du refuge « mythique » de Tuquerouye. Le refuge participe de l’organisation territoriale de la haute montagne, modifie profondément les rapports de l’homme à l’environnement montagnard. Le refuge de Tuquerouye, ou refuge Lourde-Rocheblave, est le plus ancien (1890) et le premier refuge à vocation alpine des Pyrénées. Avant lui, l’abri naturel du Mont Perdu, aménagé en 1877 à l’initiative du CAF, évoquait le mythe de la cabane primitive en haut de la montagne, mythe fondé sur l’idéal rousseauiste de retour à la nature. A l’aménagement très sommaire de l’abri naturel, vraie glacière soumise aux écoulements et suintements de la roche gelant par grand froid, répondait un confort sans doute spartiate mais un bâtiment relativement sec, rendu étanche par application de coaltar, forme de goudron obtenu par distillation de la houille et pourvu d’une cheminée ; une construction de forme ogivale ( qui allait être celle de toute une génération de refuges, comme le refuge Packe du Néouvielle, le refuge Bayssellance du Vignemale, celui du Balaïtous ou refuge Ledormeur, le refuge Alfonso XIII ou le grand refuge catalan aujourd’hui en ruines d’Ull de Ter), solidement bâtie et ancrée au sol, marquant la fin de l’époque pionnière des abris sous roche et faisant entrer la haute montagne pyrénéenne dans la modernité.
Françoise Saliou-Pedegert, doctorante en anthropologie de l’UPPA, étudie à partir d’un collectage réalisé dans la vallée d’Aspe, les termes cauç, partie restante du tronc, souche et son diminutif, cauceta. La souche, la racine, l’origine, l’estoc (employé au XVIe siècle) liés à la maison. Souche et racine renvoient naturellement à la notion d’arbre généalogique, donc en Béarn à toute la succession des mestes et daunas attachés à une maison, la lignée, le lignage, avec les traditions qui y sont attachées. Et la mémoire transmise par les aïeux. L’appartenance aussi à un lieu, à un territoire. Quant au diminutif, qu’on ne trouve dans aucun des dictionnaires gascons ni dans le Trésor dou felibrige de Frédéric Mistral, il apparaît comme le rejet de la souche, le drageon qui pousse comme une racine annexe, le rejeton, la « souchette ». Soit les membres cadets de la casa, la maison-souche, la maison casalère qui revient à l’aîné. Cadets qui sont en quelque sorte légitimés par cette dénomination comme appartenant à un ordre social communautaire qui n’a pourtant initialement rien prévu d’autre pour eux que de demeurer célibataires, attachés à la souche, au service de l’aîné ou de s’exiler dans une autre maison. Mais ces cadets, ces « rejets » jouent un rôle dans la cohésion communautaire ; ils sont en quelque sorte « en réserve » au cas où l’aîné, l’héritier naturel de la maison, viendrait à disparaître. La casa demeure immortelle et survit à la mort du cap de casa. Si tout de même il advient qu’une maison s’éteigne, la sépulture tombe dans l’oubli, comme le culte du souvenir des aïeux qui n’a plus personne pour le maintenir et l’entretenir.
Marie-Hélène Sangla, docteur en histoire de l’art, chercheuse associée, Université de Perpignan-Via Domitia, étudie l’élaboration d’une culture matérielle en Roussillon du début du XIXe siècle à la période de l’entre-deux-guerres. La Méditerranée, qui relie les rivages, induit les mêmes phénomènes naturels, véhicule des termes de civilisations communes issues de la Grèce et de Rome : ce constat, plusieurs intellectuels l’ont exprimé dans les années 1820-1845, parmi lesquels se trouvent Vincent de Chausenque, Guiraud de Saint-Fargeau, Abel Hugo, Joseph Lavallée, Adolphe Thiers, François Jaubert de Passa, Prosper Mérimée, le baron Taylor. Entre Pyrénées et Méditerranée, de la Restauration à la Monarchie de Juillet, va émerger un concept historique de civilisation dont un des facteurs dominants est l’art roman. Les Pyrénées-Orientales, avec leur zone de montagne sont un conservatoire de la culture. Selon certains géographes, comme Jalabert, le déterminisme géographique ferait des gens de plaine, zones de passage, d’échanges, des personnes qui réussissent dans le domaine économique et de ceux de la montagne des gens portés à un certain conservatisme dans les traditions, la langue (le catalan), les éléments de la culture, les monuments et ruines du passé, les églises et abbayes médiévales, comme Saint-Martin du Canigou, alors très délabrée, qui abondent en Roussillon. D’où une certaine attirance des visiteurs cultivés pour cette région. Parmi les grands spécialistes de l’art roman du Roussillon, l’archiviste des Pyrénées-Orientales de 1884 à 1889, le chartiste Jean-Auguste Brutails, auteur d’un Précis d’archéologie du Moyen Age (1888) et le catalan Josep Puig i Cadafalch qui publiera en 1928 Le Premier art roman, l’architecture en Catalogne et dans l’occident méditerranéen aux Xe et XIe siècles.
Laura Dedieu et Adrien Vertallier, architectes, étudient le territoire de Bagnères-de-Bigorre et la relation ville-campagne à travers une étude menée sur celui-ci en 2014-2015. Construire la ville avec comme acteurs essentiels ses habitants ; considérer les terres agricoles qui entourent la cité comme le socle nécessaire à la mise en œuvre de pratiques nouvelles ; approcher le territoire par l’ingénierie urbaine. Ils livrent le résultat de leur réflexion à travers leur communication.
Viviane Delpech, docteur en histoire de l’art, chercheuse associée, UPPA présente le parcours d’Eugène Viollet-le-Duc à la découverte des Pyrénées à l’époque romantique. Il aimait la montagne, ce qui motiva sa venue et son séjour de quelques mois en 1833. Artiste, il ne cessa de dessiner et de réaliser des aquarelles sur les paysages qu’il découvrait et les présenta au Salon de 1838. Soit plus d’une centaine de documents graphiques aujourd’hui conservés à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Un voyage du piémont à la haute montagne, du Pays Basque à Pau, au Béarn et à la Bigorre (Lourdes, Argelès, Luz et Gavarnie, Cauterets une incursion en Aragon, un retour à Cauterets puis un séjour à Bagnères-de-Luchon. Une peinture scientifique de la montagne et un apprentissage des matériaux, par une observation des roches (il transportait tout un équipement de minéralogiste-géologue, dont un marteau). Il s’intéressait aux marbres et il évoque la marbrerie Géruzet de Bagnères-de-Bigorre qu’il avait certainement visitée. Mais le réalisme ne l’écartait pas du sentiment romantique de son époque ni de la poésie de la montagne, une montagne à la fois réelle et idéale qu’il eut du mal à quitter (il découvrira beaucoup plus tard les Alpes).
Christophe Marquez, président de la Société d’histoire du Muretain donne une communication sur le général baron Lejeune (1775-1848), ancien des guerres napoléoniennes, élève du peintre toulousain Pierre-Henri de Valenciennes. Remarquable peintre de batailles, mais aussi peintre pyrénéiste, il devint directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse en 1837 et maire de cette ville en 1841. Il vint souvent aux Pyrénées pendant plus de vingt ans, de 1820 à 1840. Le Musée Paul Dupuy de Toulouse a récemment acquis un album de dessins à la plume et lavis brun et nous lui devons le très beau tableau Chasse à l’ours près du lac d’Oo (Musée des Augustins, Toulouse) et une aquarelle de l’église fortifiée de Luz-Saint-Sauveur, conservée au Musée Paul Dupuy.
Emmanuel Garland, docteur en histoire de l’art, clôture le congrès en étudiant la représentation des animaux dans les églises romanes des Pyrénées, animaux domestiques, animaux sauvages, animaux exotiques, bestiaire fantastique, reproduits sur des fresques, des mosaïques, des chapiteaux, modillons et tympans.
Ces Actes forment un ensemble pluridisciplinaire très dense, qui apporte un regard neuf sur les Pyrénées, donne souvent le dernier état d’une question, ouvre sur des perspectives d’avenir et pour tout cela, ils méritent une lecture approfondie.
Pierre DEBOFLE
Président de la Société Ramond
Mis en ligne jeudi 20 octobre 2016
Modifié mardi 21 février 2017